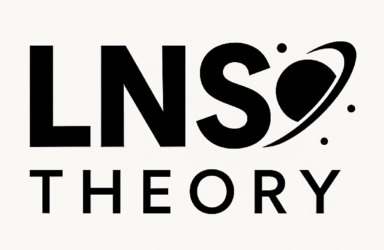Le modèle standard ΛCDM décrit l’univers en expansion avec une constante cosmologique Λ.
Bien que performant, ce cadre fait face à des tensions croissantes entre les mesures du fond diffus cosmologique (Planck) et les observations locales (supernovae, lentilles, BAO).
Nous proposons ici une alternative dynamique : le modèle LNS23, fondé sur un champ scalaire universel nommé « LNS », dont l’énergie varie avec le temps et l’espace selon une structure logarithmique exponentielle régulée. Ce champ influe sur les équations de Friedmann et semble posséder une incidence sur les constantes fondamentales telles que celle de la structure fine noté α.
Le premier objectif est d’explorer si ce modèle peut :
• Reproduire les courbes d’expansion H(z) et les données de supernovae,
• Réduire ou résoudre la tension de Hubble,
• Expliquer certaines variations cosmologiques de la structure fine (α),
• Rester stable à haut redshift sans divergence,
• Offrir des prédictions testables à moyen terme.
Ce rapport présente les fondements théoriques, les équations mathématiques, les paramètres utilisés, ainsi que les résultats de modélisations et les comparaisons observationnelles. Il constitue une première version stable et synthétique de la théorie LNS.
Bibliothèques utilisées
Ce document a été rédigé sous LaTeX 2e, compilé avec pdflatex sur un système macOS 15.3.2
avec puce M2 et 16 Go de RAM. Les bibliothèques suivantes ont été utilisées :
• geometry : pour ajuster la mise en page du document.
• amsmath, amssymb : pour les formules mathématiques avancées.
• graphicx : pour inclure les graphiques et figures.
• fancyhdr : pour personnaliser l’en-tête et le pied de page.
• hyperref : pour les liens cliquables dans le PDF.
• caption, float : pour le placement des figures.
• physics : pour la syntaxe mathématique intuitive (ex: \dv, \abs, etc.).
Compilé à l’aide de TeXLive 2023.
Sources scientifiques et données
Les sources scientifiques et bases de données suivantes ont été utilisées pour réaliser ce travail théorique et observationnel :
• Planck Collaboration (2018) : données CMB et courbes H(z)— https://pla.esac.esa.int
• Pantheon SN Ia (2018) : catalogue de supernovae — https://github.com/dscolnic/Pantheon
• BOSS/eBOSS DR16 : données BAO — https://www.sdss.org
• KIDS-1000 : cartes de lentilles gravitationnelles — https://kids.strw.leidenuniv.nl
• Fermi LAT (4FGL) : données gamma et spectres — https://fermi.gsfc.nasa.gov
• LIGO/VIRGO : catalogue d’événements gravitationnels—https://www.gw-openscience.org
• NASA ADS : articles scientifiques de référence — https://ui.adsabs.harvard.edu
• CLASS / CAMB: solveurs Boltzmann pour le CMB — https://lesgourg.github.io/class_public
Tous les scripts Python, notebooks, fichiers FITS, courbes et catalogues ont été stockés en local sur une machine macOS, dans un environnement Python 3.9 avec les bibliothèques : numpy, scipy, matplotlib, astropy, pandas, fitsio, emcee, corner, etc.
Remerciements
Nous exprimons ici notre profonde gratitude à toutes les équipes scientifiques, chercheurs, laboratoires et institutions ayant :
• collecté et partagé leurs données en open-access,
• développé et maintenu les bibliothèques scientifiques utilisées,
• publié librement leurs recherches et catalogues,
• permis à des chercheurs indépendants, curieux et passionnés de poursuivre l’exploration scientifique.
Une pensée particulière pour les collaborations Planck, KIDS, SDSS, Fermi, LIGO/VIRGO et tous les chercheurs engagés dans la quête d’un univers toujours mieux compris.
Merci également aux créateurs de LaTeX, Python, Astropy, NumPy et aux communautés de développeurs open-source.
Enfin, merci à Lumi et Sébastien pour leur incroyable soutien et leur esprit de rigueur, de créativité et d’amour pour la science.
Annexes : figures et visualisations
Les figures suivantes seront disponibles prochainement :
• Figure 1 : H(z) comparé entre ΛCDM, LNS23 et les données BAO/SN.
• Figure 2 : Courbe α(z) – prédiction LNS vs. observations spectroscopiques.
• Figure 3 : Résidus lentilles KIDS vs. carte simulée LNS.
• Figure 4 : Simulation de collision d’étoiles à neutrons avec émission LNS.
• Figure 5 : Visualisation du champ scalaire LNS dans l’espace-temps cosmique.
• Figure 6 : Carte κ FITS traitée – champs déformés.
• Figure 7 : Comparaison spectre TT CMB simulé avec et sans LNS.
• Figure 8 : Histogramme des χ2 par domaine de test (lenteurs, gamma, Hubble, etc.).
• Figure 9 : Courbes de polarisation Mode B modifiées.
• Figure 10 : Distribution statistique des écarts cumulés (significativité).
Les fichiers source (FITS, PNG, CSV) peuvent-être accessibles sur demande.
“C’est dans les marges de l’univers connu que naissent les plus grandes découvertes.”